LE GENRE HELIAMPHORA EN CULTURE. (Patrick SOUBEN)
L'acquisition, en 1989, d'un magnifique plant d'Heliamphora
minor, et les satisfactions qu'il me donna, m'incitèrent à poursuivre
plus avant l'aventure de la culture d'autres espèces de ce genre en
dépit des difficultés de culture affichées par la bibliographie, et surtout
de la grande difficulté à se procurer alors d'autres espèces. Après 6
saisons de végétation, mon intérêt pour ce genre n'a fait que croître et
m'incite à faire partager ci-après les quelques éléments d'information
glanés ça et là dans la bibliographie et ma bien modeste expérience
en la matière.
Origine géographique :
Les HELIAMPHORA sont originaires des hauts plateaux situés au
sud du bassin fluvial de l'Orénoque au sud-est du Vénézuéla, aux
confins de la Colombie, du Brésil et du Guyana .
Historique - Taxonomie :
Le mont Roraima (2730 m) est le seul tepuy dont le sommet soit
accessible à pied; c'est d'ailleurs sur ce tepuy que fut découvert par
Hermann SCHOMBURG, en 1839, le premier HELIAMPHORA auquel
Georges BENTHAM, du jardin botanique de Kew à Londres, donnera
le nom d'Heliamphora nutans (1841). Les difficultés d'accès sont telles
qu'il faudra attendre 1928 pour qu'une expédition menée par G. H.
TATE sur le mont Duida découvre d'autres espèces décrites par H. A.
GLEASON (H. tatei, macdonaldae et tyleri qui seront regroupées sous
une même espèce). Par la suite, TATE collecta H. minor en 1937 sur
l'Auyan tepuy, puis il fallut attendre 1951 pour que Julian
STEYERMARK découvre H. heterodoxa sur le Ptari tepuy, puis Bassett
MAGUIRE H. ionasii en 1952 sur l'Ilu tepuy et H. neblinae en 1953 sur
le cerro de la Neblina (ces deux espèces n'étant décrites et nommées
qu'en 1978 ! H. neblinae deviendra en 1984 une variété d'H. tatei). De
nouvelles formes et variétés sont, aujourd'hui encore, ramenées
d'expéditions lancées dans cette région par les Américains, les
Vénézuéliens et les Allemands et attendent d'être décrites et
nommées.
La taxonomie de ce genre a posé, et semble toujours poser des
difficultés aux botanistes. Ces difficultés semblent liées à la variabilité
importante rencontrée au sein de chaque espèce du fait de conditions
écologiques sensiblement différentes. Ainsi est-il rapidement apparu
que la taille et la forme des urnes étaient des caractères pouvant
prêter à confusion dans la différentiation des espèces. Les caractères
les plus fiables apparaissent dans la fleur et nécessitent parfois une
observation très détaillée au microscope (absence ou présence de
pubescence). De surcroît, il est quasiment impossible de différencier
les espèces au stade juvénile.
La difficulté de reconnaissance peut être accrue par le fait que la
répartition géographique de certaines espèces se recoupe sur
quelques tepuys, et que les HELIAMPHORA, tout comme leurs
cousines nord Américaines les Sarracenies, s'hybrident naturellement
(phénomène observé sur la chaîne du Chimanta tepuy entre H. minor
et heterodoxa, et sur le Tramen tepuy entre H. nutans et ionasii).
A cette date, le genre HELIAMPHORA regroupe donc 5 espèces distinctes, 4 variétés et au moins 6 formes:
Le milieu naturel :
Le climat au sommet des tepuys est particulièrement rude : pluies
et vents violents, très forte nébulosité pouvant alterner avec une
violente luminosité, amplitude thermique journalière importante; les
précipitations annuelles y sont de l'ordre de 2500 mm, et la
température journalière, à peu près stable sur l'année, varie de 1° à
26°C environ, ces derniers chiffres variant avec l'altitude (de légères
gelées ont été observées sur les plus hauts tepuys). La nébulosité y
est excessivement élevée, ne permettant que de rares moments de
soleil au petit matin avant que les nuages orageux montant de la forêt
Amazonienne ne viennent noyer les sommets dans un halo de
brouillard suivi de fortes pluies. Il arrive toutefois que de courtes
périodes sans pluies surviennent (la saison "sèche" s'échelonne de
novembre à mars avec un pic en janvier-février), dégageant le sommet
des tepuys de leur habituel manteau nuageux. La luminosité y est
alors d'une très grande intensité sous l'effet combiné de l'altitude et de
la proximité de l'équateur.
Le sommet qui peut être relativement plat ou présenter des
inégalités en fonction des tépuys, est partagé entre des zones de
roches nues plus ou moins chaotiques, des savanes marécageuses
plus ou moins arborées et des zones de tourbières acides (Ph de 3 à
5) dans les dépressions. Le sol existant se compose de matières
organiques plus ou moins décomposées et de sable rose issu de
l'altération du grès. En dehors des cuvettes, la capacité de rétention
en eau d'un tel sol est très faible (milieu très drainant). La plupart du
temps donc, l'alimentation en eau ne peut être assurée que par les
pluies quotidiennes.
Ces conditions écologiques particulières et l'absence de relations
avec la forêt amazonienne ou les savanes situées au pied des tepuys
ont conduit les espèces s'y étant maintenues à une adaptation
poussée aboutissant à un endémisme (estimé à 75% des espèces
végétales) que l'on peut qualifier d'insulaire. Le genre HELIAMPHORA
en fait partie.
En milieu naturel, une même espèce d'HELIAMPHORA peut
atteindre une taille allant du simple au quadruple en fonction du milieu
où elle se trouve; ainsi, un pied poussant sur un sol suffisamment
profond, bien alimenté en eau et abrité du vent et du soleil sera
beaucoup plus développé qu'un pied exposé aux intempéries, sur un
sol plus superficiel et séchant mais qui sera en revanche beaucoup
plus coloré. En tout état de cause, la croissance des HELIAMPHORA
en milieu naturel reste très lente (3 à 4 feuilles par an).
Description :
Les HELIAMPHORA sont des plantes vivaces herbacées
terrestres. Elles possèdent un rhizome souterrain d'où partent des
feuilles en forme d'urne primitive ayant encore tous les caractères
d'une feuille enroulée et soudée. L'urne est légèrement étranglée aux
2/3 de sa hauteur avant de s'évaser plus ou moins dans le 1/3
supérieur. La nervure principale de la feuille primitive se prolonge par
une cuillère à nectar de couleur rouge sur sa face interne, comportant
des glandes nectarifères, et retombant plus ou moins vers le bas pour
protéger ses sécrétions des pluies diluviennes des tepuys. La face
ventrale de l'urne porte deux ailes, correspondant aux bords de la
feuille primitive, qui partent de sa base jusqu'à l'échancrure ouvrant sur
le péristome qui permet l'écoulement de l'eau de pluie excédentaire
chez certaines espèces. Chez H. tatei et heterodoxa, les ascidies sont
munies d'un petit orifice situé entre les deux ailes au niveau de
l'étranglement qui permet de maintenir un niveau d'eau constant dans
l'urne et évite que les proies soient enlevées par l'écoulement de l'eau
excédentaire. L'urne est striée de nervures qui prennent une belle
coloration rouge-violacé lorsque la luminosité est suffisante, l'urne
pouvant elle-même se pigmenter de rouge sous une forte intensité
lumineuse. En ambiance peu lumineuse, l'extérieur de l'urne reste vert
et son intérieur vert-velouté (lié à la présence d'une pubescence
blanchâtre). L'intérieur de l'urne comprend 4 parties : au sommet, la
cuillère à nectar attire les insectes par sa couleur rouge sur sa face
interne et ses glandes à nectar. La partie supérieure de l'ascidie
comporte de minuscules poils blanchâtres dirigés vers le bas. Cette
partie reflète les rayons U.V. auxquels sont sensibles les insectes,
contrairement à l'extérieur de l'urne qui les absorbe, balisant en
quelque sorte une piste d'atterrissage pour insectes. Les poils
s'allongent au fur et à mesure que l'on s'approche de l'étranglement
qui marque la limite avec la zone suivante où se maintient l'eau. Sa
partie supérieure est cireuse et dépourvue de poils, tandis que sa
partie inférieure est munie de longs poils hérissés vers le bas.
HELIAMPHORA est dépourvue de glandes digestives. La digestion
des proies se fait donc par le biais de bactéries rendant les éléments
nutritifs des proies assimilables par la plante, à l'instar de sa cousine
nord-américaine Darlingtonia californica.
Signalons ici le cas particulier d'H. tatei qui dispose de tiges
dendroïdes (tiges rigides ressemblant à des troncs) au sommet
desquelles se développent les urnes, lui permettant de la sorte d'aller
chercher les insectes au-dessus des plantes environnantes en
atteignant des hauteurs de 1,50 à 4m.
Selon les espèces, la taille des urnes adultes varie de 5 à 50 cm,
les plus petites étant H. minor et nutans (5/30cm), les plus grandes H.
ionasii et tatei (12/50cm) en passant par H. heterodoxa (12/42cm).
Les longues hampes florales prennent naissance à la base des
urnes et peuvent porter de 2 à 7 fleurs en forme de tulipe renversée.
Une longue bractée, prenant parfois la forme d'une urne, engaine à sa
base le pédoncule floral. Le périanthe est composé de 4 à 6 tépales
de couleur blanche, rose ou verdâtre suivant les espèces. Chez
certaines espèces, la couleur des tépales évolue du blanc au
blanc-rosé ou au rose en vieillissant. L'ovaire est pubescent, prolongé
par un style et stigmate glabre. Il est entouré de 7 à 20 étamines dont
le nombre et la taille de leurs anthères entrent en compte dans la
détermination des espèces. L'autofécondation est peu fréquente chez
les HELIAMPHORA, les étamines arrivant à maturité après le pistil qui
n'est alors plus réceptif.
Don Schnell vient d'apporter récemment un nouvel éclairage sur
le mode de reproduction et la capacité des Héliamphoras à capturer
des proies ("Pollinisation of Heliamphora" et "Heliamphora : the nature
of its nurture", (1995) CPN 24 pp23/24 & 40/42).Il s'appuie sur des
études réalisées en milieu naturel par Renner sur le Cerro de la
Neblina (1985) et quatre botanistes vénézuéliens (Jaffre, et al. 1992)
qui ont passé 9 ans à étudier les 5 espèces d'Heliamphora sur 11
tépuys différents. Ces études ont été complétées par des examens de
laboratoire qui ont permis de mettre en évidence la production
d'enzymes par H. tatei dans certaines conditions de stations. Les 4
autres espèces en sont semble t-il dénuées. Les éléments assimilables
par la plante sont alors les produits de la décomposition bactérienne
(comme chez Darlingtonia californica et Sarracenia purpurea) et les
résidus de la faune et flore commensales habitant les urnes de
nombreux plants. La quantité et le type de proies capturées semble
varier sensiblement en fonction des conditions écologiques
rencontrées sur les divers tépuys, certains d'entre eux n'accueillant
qu'une flore éparse et basse, pauvre en insectes (Roraima, Kukenan),
tandis que d'autres hébergent une végétation dense d'arbustes et
buissons de plusieurs mètres de haut et une vie animale plus active.
Les cuillères à nectar y jouent alors pleinement leur rôle et permettent
ainsi d'attraper abeilles, moustiques et autres diptères (H. tatei),
fourmis, voire occasionnellement des scarabées et scorpions pour les
espèces les plus basses. Les abeilles et bourdons semblent jouer un
rôle important ans la pollinisation d'H. tatei sur le Cerro de la Neblina.
Culture des HELIAMPHORA :
Je recommande à ceux qui veulent se lancer dans la culture des
HELIAMPHORA de commencer par H. heterodoxa, nutans et/ou minor
de culture relativement aisée si l'on respecte les quelques
recommandations qui suivent (pour donner un exemple de la vigueur
avec laquelle H. heterodoxa peut se développer en culture : parti d'un
plant disposant de 3 urnes adultes en avril 1992, j'aipu obtenir ce
printemps, lors de sa division, 14 rosettes de 3 à 6 urnes chacune qui
vont toutes à merveille). Ces espèces sont disponibles sur le marché
français ou européen à des prix raisonnables comparativement aux
autres espèces (les HELIAMPHORA restent malgré tout des espèces
assez chères à l'achat).
Les HELIAMPHORA développent de longues racines et aiment
avoir de la place. Des pots de 20 cm de diamètre sont donc tout à fait
indiqués pour des plants adultes.
Le compost :
Il existe actuellement un débat sur l'utilisation de la sphaigne. Celle-ci est recommandée par certains auteurs (la majorité) qui la préconisent pure, ou en mélange avec de la tourbe (1/2-1/2), ou de la perlite (1/2-1/2). Un rempotage annuel est alors nécessaire. D'autres auteurs la proscrivent totalement; ils recommandent alors les mélanges suivants :
La sphaigne a l'avantage d'être parfaitement drainante et de
maintenir une bonne hygrométrie ambiante. Les auteurs qui l'utilisent
obtiennent de très bons résultats dans son emploi, ce que je peux
confirmer par mon expérience personnelle. Elle présente toutefois
aussi quelques inconvénients qu'il importe de connaître pour bien les
maîtriser. Il est important de la changer annuellement; il lui arrive en
effet de pourrir par le dessous sans que l'on puisse s'en apercevoir, la
surface restant parfaitement verte. J'en ai fait l'amère expérience en
perdant de la sorte un pied de DARLINGTONIA de 7 ans que je
n'avais pas cru utile de rempoter depuis 3 ans, estimant qu'il avait
assez d'espace pour se développer. Lorsque la pourriture a attaqué le
rhizome, il était alors trop tard. De plus, lorsque la sphaigne vieillit,
elle présente une allure brunâtre et perd ses qualités drainantes,
pouvant entraîner une pourriture des racines. Le troisième
inconvénient réside dans la vitesse de croissance de la Sphaigne;
celle-ci tend à recouvrir les jeunes plants qui ne peuvent rivaliser de
vitesse, ou recouvre complètement le bas des plants adultes, limitant
le développement des jeunes urnes. Cela peut être corrigé par une
taille régulière.
Le rempotage reste une opération délicate pour les
HELIAMPHORA. Celles-ci sont en effet très cassantes, tant au niveau
des urnes que des racines, ces dernières l'étant d'autant plus qu'elles
sont longues. Les racines seront débarrassées de leur ancien substrat
par un bain et replacées délicatement dans leur nouveau pot en
tassant le nouveau substrat légèrement au fur et à mesure. La plante
sera ensuite bassinée pour permettre au nouveau substrat de bien se
mettre en place.
L'humidité :
Les températures :
La lumière :
La dormance :
La fertilisation :
Les maladies :
La multiplication d'HELIAMPHORA :
Le semis :
La multiplication par semis semble une opération
délicate tant au niveau de la fécondation que de la croissance des
plantules parmi lesquelles le taux de mortalité est souvent élevé.
Comme indiqué plus haut, il est nécessaire de pratiquer la
pollinisation croisée pour obtenir quelques chances de succès. Le
stigmate arrive à maturité dès l'ouverture de la fleur et ne le reste que
peu de jours, suite à quoi il n'est plus réceptif au pollen de la fleur qui
arrive à son tour à maturité. Il importe donc de collecter du pollen sur
une autre fleur et de le transférer sur le stigmate d'une fleur venant
juste de s'ouvrir. Certains auteurs ont ainsi pu aboutir à la création
d'hybrides horticoles entre H. minor, heterodoxa, nutans et même
pour l'un d'entre eux avec H. ionasii. Les semis sont réalisés sur
tourbe ou sphagnum haché, ce dernier milieu ayant l'inconvénient de
recouvrir rapidement les jeunes plantules qu'il convient alors de
repiquer. Celles-ci sont maintenues à plus de 20°C en lumière tamisée
et lèvent sous 6 semaines environ. Il est même rapporté que des
graines continuaient de germer 9 mois après leur semis. Les plantules
sont extrêmement délicates et le repiquage doit être très méticuleux. Il
arrive malgré tout que la mortalité soit importante, la croissance des
plantules restant de toute manière très lente.
Le bouturage :
Le bouturage reste encore aujourd'hui la méthode
la plus sûre de multiplier les HELIAMPHORA, abstraction faite de la
micro propagation in vitro que certains auteurs commencent à bien
maîtriser, mais qui reste l'apanage d'une "élite".
Cette opération peut se pratiquer dès que les signes d'une reprise
de végétation soient apparus au printemps. La plante à diviser doit
être suffisamment développée pour ne pas l'affaiblir. Elle est
délicatement sortie de son pot, à l'occasion du rempotage par
exemple, et sa partie souterraine lavée dans l'eau. Le rhizome sera
sectionné de manière nette par un outil coupant et devra comporter
au moins 3 à 5 urnes. COTTER mentionne le bouturage d'un fragment
de rhizome dénué de feuilles; celui-ci reprit au bout de 6 mois. La
bouture de feuille est également possible mais apparaît plus aléatoire
en fonction des espèces. Elle donne de bons résultats avec H.
heterodoxa et minor au moins. Lors du rempotage de printemps,
l'urne doit être délicatement prélevée du rhizome en s'assurant qu'elle
s'enlève bien au ras du rhizome. Elle est ensuite conduite à plus de
20°C en lumière tamisée avec une forte hygrométrie dans un milieu
drainant de type Sphaigne. Le Dr DEGREEF mentionne également
une tentative de bouturage d'une bractée ayant les caractères d'une
feuille.
Espèces disponibles sur le marché :
Heliamphora minor, heterodoxa et nutans sont disponibles sur le
marché français ainsi que quelques hybrides horticoles. H. ionasii est
disponible chez un pépiniériste anglais à un prix élevé et en très petite
taille (2 cm environ). Wistuba semble contester son identification et
pense qu'il s'agirait d'une espèce nouvelle non identifiée provenant
également de l'Ilu tepuy. H. tatei var. tatei est disponible depuis cette
année en Allemagne à un prix élevé sous forme de plant juvénile de 2
à 3 cm. Un hybride naturel entre H. ionasii et nutans provenant du
Tramen tepuy est également disponible en Allemagne.
A titre indicatif, les prix s'échelonnent de 100 à 620FF pour les
espèces disponibles à la vente chez ces différents pépiniéristes.
Souvenez-vous toutefois qu'un plant adulte, même s'il est plus cher à
l'achat, donne plus de satisfactions et offre plus de garanties.
Signalons la mise sur le marché par A. Wistuba d'H. ionasii (qu'il
considère comme étant la forme authentique) pour 700Frs environ
(jeune plant issu d'In Vitro)
Pour les "acharnés" des tépuys, l'allemand Joachim Nerz propose
un voyage-découverte de 13 jours sur 4 d'entre eux pour 4100$ (du 8
au 20 janvier 1996)
Références bibliographiques consultées :
Cet inventaire serait incomplet sans citer les deux films
documentaires sur les tépuys Vénézuéliens qui ont fait rêver les
membres de l'association présents à l'A.G. de 1993 : "Le crépuscule
des dieux" et "Les îles de la forêt" de Gottfried KIRCHNER.
DIONÉE 33 - 1995
|

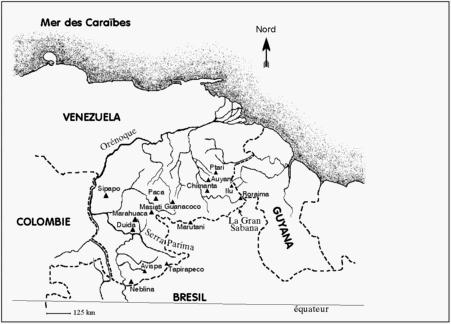 Ces plateaux (mésas), essentiellement composés de grès
précambrien, se sont progressivement retrouvés coupés du reste du
monde à l'ère tertiaire, pense t-on, sous l'effet d'une érosion
hydraulique. Ils présentent des parois abruptes de plusieurs centaines
de mètres de haut bordées en contrebas par des résidus de l'érosion
et des éboulis. Ces hauts plateaux, communément appelés tepuys à
l'est et cerros à l'ouest, ont une altitude variant pour les plus
importants d'entre eux de 1200 m à 3045 m pour le Cerro de la
Neblina.
Ces plateaux (mésas), essentiellement composés de grès
précambrien, se sont progressivement retrouvés coupés du reste du
monde à l'ère tertiaire, pense t-on, sous l'effet d'une érosion
hydraulique. Ils présentent des parois abruptes de plusieurs centaines
de mètres de haut bordées en contrebas par des résidus de l'érosion
et des éboulis. Ces hauts plateaux, communément appelés tepuys à
l'est et cerros à l'ouest, ont une altitude variant pour les plus
importants d'entre eux de 1200 m à 3045 m pour le Cerro de la
Neblina.
