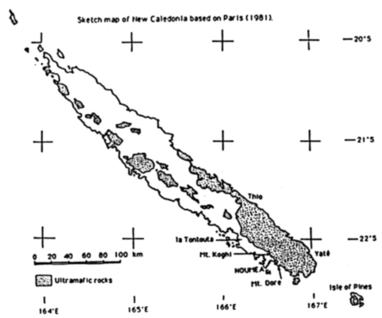|
PLANTES CARNIVORES DE NOUVELLE-CALEDONIE Précédemment paru dans Flytrap News, Volume 4 Numéro 2, 1990
(R. Gibson - Traduction S. Lavayssière)
Cet article fait suite à des vacances familiales en Nouvelle Calédonie qui eurent lieu
du 1er au 11 janvier 1989. La raison principale de ce voyage était récréative, j'eu
la certitude de trouver 3 des 5 espèces autochtones dans leur biotope naturel. Les
Plantes Carnivores de Nouvelle-Calédonie ne sont qu'une petite partie de la flore
fantastique qui couvre l'île et qui est un héritage de la fascinante histoire
géologique de ces îles. Un résumé rapide de l'histoire géologique de
Nouvelle-Calédonie est nécessaire avant tout. Cette île est un fragment de Gondwana,
soit une partie du super continent regroupant l'Australie, I'Antarctique, I'Inde,
I'Afrique et l'Amérique du Sud (White, 1986). Ce groupe commença a se disloquer au
cours du Jurassique (il y a environ 180 millions d'années) pour se stabiliser au
début de l'ère Tertiaire (il y a 65 millions d'années) avec la séparation de la
Nouvelle-Calédonie et de l'Australie. La Nouvelle Calédonie emporta avec elle un
échantillonnage de la végétation du début du Tertiaire qui évolua isolément.
L'événement le plus important suivant ceci fut l'installation d'une remontée de la
croûte océanique, ou ophiolite, au cours de l'Eocène, il y a 55 à 38,5 millions
d'années ( Brothers and Lille, 1988). La minéralogie de l'ophiolite est dominée par le
fer, le manganèse, le nickel et le chrome avec de plus faibles quantités de calcium,
phosphore et potassium, entre autres. De telles concentrations minérales ne sont
généralement pas favorables à la croissance des végétaux, mais, au cours des
millénaires, les plantes de Nouvelle-Calédonie ont évolué pour s'adapter à de telles
conditions où elles formèrent un type de végétation connu sous le nom de "maquis"
(en français dans le texte). Depuis l'Eocène, la couche d'ophiolite s'est stabilisée,
formant des bassins, en particulier dans le sud de l'île principale, une part
substantielle du massif ultrabasique a subi l'érosion, et une élévation s'est produite
dans le Sud-Est de l'île. Les sols résultant du massif ultra-alcalin, qui couvre
6000 km2, soit 30% de 1'île principale (Schmid, 1981), présentent une minéralogie
similaire à celle de la roche mère. Des espèces de Plantes Carnivores sont une
partie des végétaux qui furent capables de coloniser de tels sols. Ces rapports
minéraux-végétaux se rencontrent en d'autres lieux dans le monde, par exemple
avec Darlingtonia californica sur la serpentine dans l'Ouest de l'Amérique du Nord
(Schnell, 1976), et certains Nepenthes sur ophiolite au Mont Kinabalu ; sans nul
doute, il en existe de nombreux autres exemples. La date de l'arrivée des Plantes
Carnivores en Nouvelle-Calédonie, reste encore inconnue. Il semble évident
aujourd'hui que les Droséras sont arrivés durant ou juste après la séparation entre
l'Australie et la Nouvelle Calédonie (Degreef, 1989), et les Nepenthes sont sans
doute aussi arrivés après la séparation, grâce a des graines portées par le vent
depuis la Nouvelle Guinée proche (Lowrie, 1988, correspondance personnelle).
Les Plantes Carnivores de Nouvelle-Calédonie sont les suivantes:
Ma famille arriva à l'aéroport de La Tontouta après 2 heures et demie de vol à
partir de Sydney. De là, nous prîmes la route jusqu'à Nouméa, à 54km, où nous
nous installâmes à l'Hôtel île de France. Le temps était chaud, agréable et ensoleillé
ce qui ne dura pas puisque les deux jours suivants un cyclone tropical nommé
Delilah balaya la côte Est de l'île. Les conditions de vent et d'humidité étaient très
intéressantes à expérimenter ! Le ciel commença à s'éclaircir l'après-midi du
mardi 3 janvier 1989, mais les rivières étaient toutes en crue et les montagnes de
I'intérieur restaient masquées par des nuages. Le temps redevint clément, avec des
orages d'après-midi, pour le reste de nos vacances à l'exception d'un seul jour.
Durant cette période, j'ai eu l'occasion de visiter trois sites à plantes carnivores,
tous situés à quelques heures de Nouméa. Ces sites sont décrits ci dessous.
Mont Kochi
Un petit groupe de sommets ultramafiques (N.D.T.: roches d'origine magmatiques
riches en magnésium et en fer) se situe à environ 40km au Nord Est de Nouméa. Il
est accessible par la RT1, qui passe par le Col de Tonghoué. La bifurcation vers le
Mt Koghi est a environ 2km du col, vers la gauche. La petite route balayée par le
vent commence au milieu d'une végétation luxuriante, avec quelques maisons et
jardins. Elle traverse de nombreux ruisseaux en serpentant sur les premiers
versants du Mt Koghi. La végétation change brutalement après environ 3km de
route. La route fait un brutal virage à droite à l'endroit où la haute forêt humide
laisse place à une végétation dominée par de bas arbustes nommée "maquis"
(Schmid, 1981). C'est dans ce "maquis" que se trouve N. vieillardii. La route
continue encore sur 2km environ jusqu'à un point de vue, un restaurant et un site
touristique à une altitude d'environ 500m. Un petit spécimen mâle de N. vieillardii
se trouve à l'entrée du restaurant. De là, partent de nombreuses pistes difficiles
qui mènent à de nombreux sommets (jusqu'a 1079m d'altitude). Ce sire se trouve
dans une zone de forêt humide, due sans doute à la présence d'une arête granitique
et à l'accumulation de matériaux organiques et nutritifs. N. vieillardii se trouve
depuis le début du maquis jusqu'au restaurant, mais également certainement à
d'autres endroits éloignés de la route. Il a une prédilection pour les ravins et des
sites accidentés, de nombreuses stations étant d'origine humaine, mines ou déblais
de routes, utilises comme habitat par cette espèce. Ce Nepenthes pousse parfois au
pied de buissons où il est généralement caché par les feuilles. Le plus beau site
que j'ai vu était un large ravin, juste au nord de la route, long de 100m, large de
8 à 10m et profond de 3m. Il était évidemment artificiel. Ici, N. vieillardii pousse en
abondance et de nombreuses plantes ont des tiges grimpantes, chose rare sur des
plantes trouvées ailleurs que sur des ravins. La fréquence moindre de tiges
grimpantes sur les plantes à l'extérieur des ravins est peut-être due aux plus
fréquents feux de maquis, les plantes des ravins sont mieux protégées.
La couleur des urnes varie, mais les péristomes sont généralement rouges, le reste
de l'urne étant plus ou moins tachetée de rouge. Beaucoup de plantes étaient en
fleurs et des capsules de graines pas encore mûres étaient communes. Les plus
belles plantes trouvées en dehors du ravin étaient un groupe poussant sur un arbre
presque mort. Je les remarquai seulement lors de notre dernière visite. Les
nombreuses branches de plusieurs mètres se terminaient en une rosette compacte de
feuilles, typique de cette forme de l'espèce. La prolifération des rosettes produisait
un amas de feuilles et d'urnes qui tapissaient l'arbre; Des tiges florales mâles et
femelles étaient visibles, indiquant qu'au moins deux plantes poussaient ensemble.
Je n'ai pas trouvé d'autres plantes carnivores au Mont Koghi, mais il est fort
probable que D. neo-caledonica pousse sur ce site.
Il pourrait être intéressant de citer quelques-unes des plantes poussant avec
N. vieillardii dans cette végétation de "maquis": Eraxis rigida, Megastylis gigas
(deux orchidées terrestres), Cunonia macrophylla, divers Dracophyllum (certains de
deux mètres de haut), ainsi que des fougères et de nombreux Carex. Quelques
plantes intéressantes de la forêt humide sont Angiopteris evecta et autres fougères,
Lesloonea koghiensis, Pandanii, figuiers, Kauris et palmiers (Schmid, 1981).
DIONÉE 23 - 1991 |