|
Plantes Carnivores de nos régions (Pierre SIBILLE)
Les grassettes (suite)
Les grassettes de nos régions ( 1 ) mériteraient de retenir l'attention
même si elles ne présentaient pas la particularité d'être des plantes
insectivores. Cette propriété a été longtemps contestée, tant aux
grassettes qu'aux utriculaires; l'éminent botaniste Gaston Bonnier
exprimait son scepticisme à ce sujet dans sa monumentale Flore complète
de France, Suisse et Belgique. Toutefois, des observations suivies ont
permis de reconnaître l'aptitude qu'ont ces plantes à capturer de très
petites proies et à les digérer grâce à des enzymes détectés lors de
travaux scientifiques récents.
Capture et digestion des proies : La loupe permet de distinguer, sur
le dessus des feuilles de grassette, une multitude de glandes. Les unes,
et de loin les plus nombreuses, sont sessiles, les autres sont pédonculées.
Chacune de ces dernières porte un globule de mucilage sécrété par la
glande. lncolores et minuscules, ces milliers de gouttelettes donnent au
limbe un revêtement "gras" et comme lustré.
En l'absence de nectar, les moucherons sont-ils attirés par la faible
odeur de champignon que dégage la plante ? lls sont nombreux, en
tout cas, à venir se poser et s'engluer sur le limbe visqueux. C'est alors
que les glandes sessiles se mettent à sécréter un fluide digestif,
légèrement acide, où l'on a reconnu quatre enzymes : ribonucléase,
estérase, phosphatase acide et protéase.
Dans son livre "Carnivorous Plants", Adrian Slack estime que
"l'activité bactérienne, si toutefois elle intervient dans la digestion,
ne semble y jouer qu'un faible rôle. En fait, la sécrétion semble plutôt
contenir un bactéricide léger et il y a peu de doute qu'une telle activité
(bactérienne) ne soit préjudiciable à la feuille dont le limbe est très
délicat" A l'appui de cette affirmation, A. Slack analyse ce qui se produit
quand une trop grosse proie est déposée sur le limbe. La digestion ne
pouvant s'effectuer complètement, l'activité bactérienne se développe et,
du corps de l'insecte, se propage à la feuille qu'elle peut corrompre.
Ce mode de capture et de digestion rapproche nos grassettes des
rossolis (ou drosera). Pour ces derniers, on constate (voir Dionée 1) un
lent mouvement des "tentacules", suivi parfois d'un faible enroulement
du limbe. Chez nos Pinguicula aussi, on peut observer une légère courbure
des bords du limbe. Ce "mouvement",insensible, ne peut jouer le moindre
rôle dans la capture des insectes mais il permettrait de retenir comme
dans une "cuvette" les sucs digestifs agissant sur les proies.
* Reproduction et hibernation
Les grassettes se multiplient par reproduction sexuée (graines) et
par reproduction végétative (hibernacle et gemmae).
Pollinisées par les insectes, les fleurs de Pinguicula donnent rapidement
des capsules pleines de toutes petites graines de forme allongée
(croquis dans Dionée 2).
Dépourvus de racines bien développées (sauf chez Pinguicula
alpina) l'hibernacle et les gemmae sont souvent entraînés et dispersés
par la pluie et la neige, ce qui favorise la propagation de l'espèce. Au
printemps, chaque hibernacle, chaque gemma qui aura eu la bonne fortune
de se retrouver sur un terrain convenable, formera une nouvelle rosette
de feuilles ainsi que des racines. Ce mode de reproduction végétative se
révèle parfois plus performant que la multiplication par graines, par
exemple chez Pinguicula grandiflora dont un pied-mère peut générer
jusqu'à cinquante gemmae.
* Culture
Les grassettes de nos régions sont, me semble-t-il, plus capricieuses
en culture que leurs cousines exotiques. Celles-ci, et en particulier
les belles grassettes mexicaines demandent, il est vrai, l'abri de la
serre ou du terrarium, alors que nos Pinguicula - mis à part, peut-être
Pinguicula lusitanica - sont des plantes d'extérieur. On peut les
cultiver à l'ombre, dans un endroit frais, en pots (le compost étant
maintenu humide pendant la période de végétation active) ou en
mini-tourbière.
Un filet protègera les plantes des oiseaux qui aiment à piocher la
terre mouillée à la recherche de vers, et il faudra aussi prendre garde
aux limaces et escargots, friands des feuilles tendres.
Les trois principales espèces indigènes (Pinguicula vulgaris, Pinguicula
alpina et Pinguicula grandiflora) s'obtiennent aisément à partir de
graines. Là encore, référons-nous aux précieuses pages d'A. Slack.
Effectuer les semis en décembre-janvier, en dispersant les graines
à la surface d'un mélange de tourbe et sable. La terrine à semis, placée
en permanence sur un plateau contenant de l'eau de pluie, sera installée
dans un châssis bien aéré. On exposera le semis à la gelée le plus
souvent possible, le froid devant favoriser la germination. Celle-ci a
lieu au printemps. En cas d'échec, renouveler l'opération avec le même
semis. Les plantules, après repiquage, acquerront pour la plupart, une
semi-maturité en été, avant de former leurs hibernacles.
J'ajouterai ceci : même si l'on conduit à bon terme cette délicate
culture, nos sauvageonnes ne paraîtront jamais aussi belles, aussi bien
portantes que sur les rochers moussus éclaboussés par quelque cascade
de montagne. Nos grassettes comme tant d'autres plantes sauvages
s'acclimatent difficilement hors de leur habitat d'origine. Allons
les admirer "chez elles" et adoptons plutôt pour nos cultures les
espèces exotiques si variées, si attrayantes et tellement plus
accommodantes !
(1) Voir Dionée n°2 - mars 1984
DIONÉE 3 - 1984
|

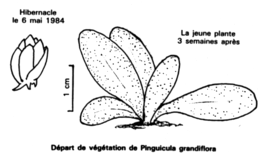 A l'exception de Pinguicula lusitanica, la rosette de feuilles de nos
grassettes régresse en fin d'été alors qu'en son centre se forme un
bourgeon d'hiver, ou hibernacle. Quand les feuilles ont disparu, on
peut voir, sur le pourtour de l'hibernacle, d'autres bourgeons plus
petits, les gemmae.
A l'exception de Pinguicula lusitanica, la rosette de feuilles de nos
grassettes régresse en fin d'été alors qu'en son centre se forme un
bourgeon d'hiver, ou hibernacle. Quand les feuilles ont disparu, on
peut voir, sur le pourtour de l'hibernacle, d'autres bourgeons plus
petits, les gemmae.
